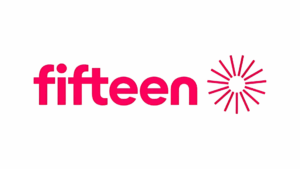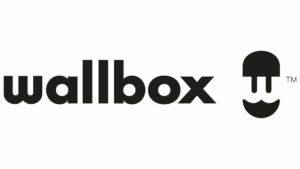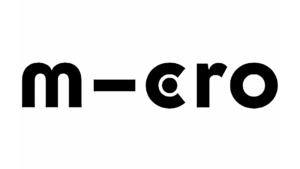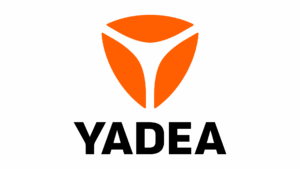Autopartage, vélos en libre-service, trottinettes électriques, covoiturage urbain, flottes d’entreprise électrifiées… La mobilité partagée s’impose comme un pilier essentiel de la transition vers des déplacements plus durables. Pourtant, si les innovations techniques se multiplient, la communication autour de ces services reste un exercice délicat. Dans un secteur où les usages, les publics et les perceptions varient énormément, les relations presse (RP) doivent allier pédagogie, transparence et ancrage territorial.
Voici les principaux écueils à éviter pour construire un discours crédible, lisible et efficace autour de la mobilité partagée.
1. Éviter le jargon techno : simplifier sans dénaturer
Le secteur de la mobilité regorge d’acronymes et de termes techniques : MaaS, API, IoT, V2G, smart grid, etc. Si ces concepts sont parlants pour les initiés, ils peuvent vite devenir hermétiques pour le grand public ou même pour certains journalistes généralistes.
👉 L’enjeu : rendre le propos accessible sans appauvrir le fond.
Dans un communiqué ou un dossier de presse, il est préférable de privilégier les formulations simples et les exemples concrets :
- « Notre service d’autopartage 100 % électrique » plutôt que « Notre plateforme MaaS intégrée ».
- « L’application permet de réserver une voiture en deux clics » plutôt que « une interface optimisée via API ».
Une bonne règle : si le lecteur doit chercher un mot sur Google pour comprendre, c’est qu’il faut reformuler. Les journalistes apprécient les explications claires et imagées, surtout lorsqu’il s’agit de sujets techniques.
2. Représenter les usagers : donner la parole à ceux qui roulent, pédalent et partagent
La communication autour de la mobilité partagée ne peut pas reposer uniquement sur la technologie ou le modèle économique. Ce qui fait la force d’un service, c’est l’usage qu’en font les citoyens au quotidien.
👉 L’enjeu : incarner les discours.
Intégrer des témoignages d’utilisateurs (particuliers, salariés, collectivités) permet de montrer la réalité de terrain. Quelques données d’usage bien choisies (nombre de trajets, taux d’abonnement, kilomètres économisés, émissions évitées) donnent de la crédibilité et facilitent la reprise médiatique. Les journalistes sont toujours preneurs d’exemples humains : une habitante d’une ville éloignées d’un service de transports en commun qui a abandonné sa deuxième voiture, un livreur passé à la flotte électrique, une collectivité qui mutualise ses véhicules pour les agents et les citoyens.
Les RP doivent donc faciliter l’accès à ces profils, préparer les interviews, et construire un récit qui mette les usages au cœur de la communication.


3. Gérer les incivilités : ne pas nier les problèmes, mais montrer les solutions
Abandon de trottinettes sur les trottoirs, dégradations de vélos, non-respect du code de la route… Les incivilités associées à la mobilité partagée font régulièrement la une. Tenter de les minimiser est souvent contre-productif : le public et les médias perçoivent vite les discours trop lisses.
👉 L’enjeu : adopter une communication responsable et proactive.
Il est essentiel de reconnaître les difficultés, tout en mettant en avant les actions concrètes menées pour y remédier :
- campagnes de sensibilisation,
- partenariats avec les municipalités,
- amélioration des outils de signalement,
- renforcement du service de maintenance ou de récupération.
Les RP peuvent accompagner ces démarches en proposant aux médias des visites terrain, des interviews d’opérateurs ou des bilans d’impact, pour montrer que le sujet est pris à bras-le-corps.
Une communication honnête et ancrée dans les faits renforce la confiance, surtout dans un secteur encore jeune et observé de près.
4. Montrer la diversité des contextes : la mobilité partagée ne se vit pas qu’en centre-ville
La mobilité partagée n’a pas la même réalité à Paris, à Angers ou dans un village du Cantal. Or, la plupart des discours médiatiques se concentrent encore sur les métropoles.
👉 L’enjeu : adapter le message aux territoires et aux usages.


Les besoins de mobilité diffèrent selon qu’on parle de trajets domicile-travail, de déplacements professionnels, de loisirs ou de transport scolaire. Dans les zones rurales ou périurbaines, le partage de véhicules utilitaires ou le covoiturage du dernier kilomètre peuvent avoir un impact bien plus fort qu’un service de free-floating. Les RP doivent donc contextualiser : expliquer en quoi une solution répond à un besoin local précis. Miser sur des partenariats territoriaux, citer des exemples de villes pilotes et souligner la complémentarité avec les transports publics renforce la légitimité du discours. L’approche “un message pour tous” ne fonctionne plus ; place à la communication sur mesure.
La mobilité partagée est une formidable opportunité de repenser nos déplacements et nos modes de vie. Mais sa réussite passe aussi par une communication claire, humaine et sincère. Les RP ont un rôle stratégique : traduire la complexité technique en bénéfices concrets, donner une voix aux usagers, assumer les défis et valoriser la diversité des territoires. En évitant ces pièges, les acteurs de la mobilité partagée gagnent non seulement en visibilité, mais surtout en crédibilité — une ressource précieuse dans un secteur en pleine transformation.